
Des mers bruyantes aux systèmes de navigation en passant par les collisions avec des baleines, Amy Deeb, P.Eng., ingénieure en systèmes autonomes, décompose les problèmes en leurs éléments de base afin d’élaborer des solutions innovantes.

Qu’ont en commun les petits bateaux de pêche aux prises avec des problèmes de bruit, la probabilité qu’un navire rencontre une baleine et un véhicule sous-marin autonome (AUV) naviguant dans les glaces ? Amy Deeb, P.Eng., ingénieure en systèmes autonomes en Nouvelle-Écosse, s’est attaquée chacun de ces défis en utilisant ses compétences en génie, son sens de l’innovation et sa connaissance des systèmes autonomes pour apporter des solutions pratiques à des problèmes du monde réel.
Amy Deeb, fait carrière dans l’utilisation de systèmes autonomes pour résoudre des problèmes vastes et complexes, en recherchant des schémas dans les données et en les réduisant aux termes les plus simples où la solution peut être trouvée. Les systèmes autonomes sont particulièrement bien adaptés non seulement pour recueillir des données, mais aussi pour trier un grand nombre de variables afin trouver des schémas cachés qui peuvent déboucher sur des solutions révolutionnaires.
Voir à travers le bruit
En raison de l’activité humaine, les océans deviennent très bruyants, les niveaux de bruit à basse fréquence ayant plus que doublé chaque décennie depuis 1950. Ce bruit a un énorme impact sur la vie marine et peut par conséquent avoir des incidences sur des industries maritimes telles que la pêche.
L’un des projets les plus enrichissants de Mme Deeb a consisté à travailler directement avec des pêcheurs de la côte Est qui utilisent des bateaux de type Cape Island. « Ce projet m’a beaucoup plu parce qu’il a eu un impact direct. Nous avons discuté avec des pêcheurs de l’effet de la performance de leurs bateaux sur leurs moyens de subsistance et, en particulier, de la façon dont ils ressentent le bruit ; ils comprenaient ces choses intuitivement de par leur expérience et nous avons pu les étayer avec des données », a expliqué Mme Deeb. Le bruit des navires peut pousser la faune marine, y compris les poissons et les baleines, à déplacer leur habitat, ce qui modifie les zones de pêche. Même si les grands navires produisent plus de bruit que les plus petits, l’impact peut s’accroître si plusieurs pêcheurs travaillent systématiquement dans le même secteur.

Amy Deeb et son équipe ont utilisé des hydrophones, c’est-à-dire des microphones sous-marins, pour recueillir des données au large de la Nouvelle-Écosse, près de Peggy’s Cove. « L’un des défis que nous posent les bruits rayonnants sous-marins est que nous ne sommes pas seulement préoccupés par leur volume. La hauteur du bruit influe aussi sur la nocivité. » Le spectre sonore est influencé par de nombreux facteurs tels que la forme et les matériaux du navire et sa vitesse de fonctionnement ; il existe également des facteurs environnementaux qui affectent le son, tels que la profondeur et la température de l’eau, et l’environnement général. Tous ces facteurs devaient être pris en compte afin de rechercher des schémas, de limiter le nombre de paramètres et de déterminer les impacts les plus importants. « Pour modéliser cela, il est plus facile d’utiliser des techniques d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine, car il existe une grande variété de facteurs et il est difficile de construire un modèle basé sur la physique qui puisse définir comment le bruit passe du navire à l’eau », a expliqué Mme Deeb.
Les informations ont été communiquées directement aux pêcheurs. Amy Deeb et son équipe ont identifié les différences de bruit entre les divers régimes de moteur, et lorsque les coques des navires étaient propres ou encrassées. Ce projet a tenu compte de l’équipement utilisé par les pêcheurs, de leurs façons de travailler et des moyens qui leur permettraient de modifier leur volume de bruit en fonction de leurs capacités et de leurs besoins, dans le but de leur fournir des informations pratiques et exploitables.
Prévoir les mouvements
Dans le cas des bateaux Cape Islander, l’équipe d’Amy Deeb s’est attachée à modéliser la source du bruit sous-marin afin d’aider les opérateurs de navires à identifier des solutions de réduction du bruit. Dans le cadre d’un autre projet, l’équipe a changé d’optique pour modéliser les mammifères marins affectés par le bruit sous-marin.
Située au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, la plate-forme néo-écossaise abrite plusieurs espèces de baleines tout au long de l’année, qui risquent d’être heurtées par de grands navires ou d’être affectées par des bruits forts. Les navires commerciaux, les bateaux de croisière, les équipes de construction en mer et autres doivent comprendre le niveau de risque qu’ils représentent pour les baleines et comment ce risque évolue. Mme Deeb a appliqué un modèle probabiliste à des systèmes biologiques, afin d’examiner la probabilité que des navires heurtent des baleines. Dans le cas d’un problème comme celui-ci, la probabilité d’une collision est faible, mais l’impact d’un tel incident peut être catastrophique. « Si nous parvenons à bien modéliser cette situation et à comprendre comment ce risque évolue dans le temps, nous pourrons alors déterminer les mesures qui devraient être prises », a-t-elle expliqué.
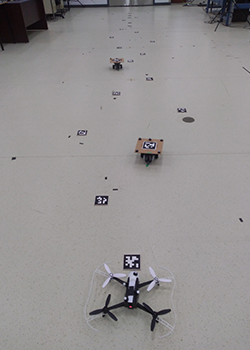
Les mouvements des baleines varient selon les saisons, ce qui détermine la durée de leur séjour, leurs activités, la fréquence à laquelle elles remontent à la surface, et bien d’autres choses encore. « L’intérêt d’un modèle probabiliste est qu’il semble très simple sur le papier : la probabilité de la présence d’une baleine est une solution à quatre termes. Mais la modélisation de chacun de ces termes est extrêmement complexe et nécessite une énorme quantité de données que nous ne possédons pas encore », a indiqué Mme Deeb.
Les travaux d’Amy Deeb ont permis d'en savoir plus sur le type et l'étendue des données qui doivent encore être recueillies pour prédire correctement quand et comment les baleines se déplacent.
L'idée de modéliser les mouvements des baleines de manière probabiliste a découlé du sujet auquel s’est intéressée Mme Deeb pendant ses études de doctorat, à savoir la localisation et la cartographie simultanées, également appelée SLAM.
La SLAM permet à un véhicule sous-marin autonome de se repérer dans le monde sans carte. En eaux profondes, un véhicule autonome ne peut pas utiliser le GPS pour déterminer où il se trouve. Comment se localise-t-il, pour savoir où il se trouve et où il doit aller? Une réponse consiste à trouver des points de repère, tels que des caractéristiques notables du fond marin, et à déterminer l'endroit où il se trouve en suivant son mouvement par rapport à ces points de repère. Pour son doctorat, Amy Deeb a envisagé l'utilisation d'un véhicule aérien dans l'Arctique canadien, où le GPS n'est pas toujours fiable. Dans cette région, les principaux points de repère sont les banquises, qui ne sont généralement pas statiques. Elles se déplacent. Alors que faire lorsque vos points de repère se déplacent eux aussi?
La solution d’Amy Deeb utilise les observations des mouvements passés d’une banquise pour prédire sa position. À leur manière, les banquises se déplacent de façon très cohérente, ce qui permet d’inclure leur mouvement dans le modèle probabiliste. « Une fois que vous avez ramené ce mouvement à quelque chose de logique, vous l’intégrez dans votre modèle et vous continuez », ajoute Mme Deeb. Le défi consiste à déterminer à quelle partie du problème le système doit répondre – et à disposer de suffisamment d’informations pour y répondre correctement.
Sauvegarder les technologies futures
Lloyd’s Register, où travaille Amy Deeb, compte plus de deux siècles d’histoire et d’expérience dans le domaine de la technologie maritime. L’un des principaux objectifs de l’entreprise britannique est « Engineering a safer world » (façonner un monde plus sécuritaire), un mot d’ordre qui interpelle fortement Mme Deeb. « L’organisation apporte une réelle contribution à la manière dont nous envisageons les risques et dont nous pensons disposer des capacités adéquates pour protéger les gens, l’environnement et nos systèmes pour l’avenir. J’espère que mon travail y contribue modestement », a indiqué Mme Deeb.
L’un des aspects les plus intéressants de son travail, ajoute-t-elle, est que Lloyd’s Register encourage activement ses ingénieurs à se projeter dans les décennies à venir, à envisager quels pourraient être les plus grands défis, et à réfléchir aux lignes directrices à mettre en place pour se prémunir contre les risques éventuels, ce qui rend son travail particulièrement adapté à l’étude des incidences des systèmes numériques à grande échelle.
Il s’agit en partie de s’assurer que les nouvelles technologies numériques mises au point résoudront des problèmes réels auxquels les gens sont confrontés et ne créeront pas de nouveaux problèmes imprévus. « Les systèmes que nous développons en comprenant bien où ils devraient être utilisés et où ils ne devraient pas l’être sont beaucoup plus efficaces », explique Amy Deeb.
Dans le cas des systèmes numériques, il est plus difficile de faire bien comprendre à l’utilisateur comment un système ne devrait pas être utilisé. L’échelle à laquelle les systèmes numériques sont déployés ne fait qu’ajouter à ce problème. « En réalité, les êtres humains comprennent une certaine échelle de taille... et je pense que nous avons une intuition des environnements sur lesquels nous avons un impact. Mais lorsque nous commençons à travailler avec des systèmes numériques qui touchent des millions de personnes, avec des systèmes que nous pouvons distribuer dans une énorme variété de cas d’utilisation, nous perdons de vue certains des détails du travail à cette échelle. » Pour Amy Deeb, « l’évolutivité sera un très grand défi pour les ingénieurs ».
Des solutions transférables
Chaque jour est une nouvelle aventure pour Amy Deeb. « Chaque fois qu’on a une idée, je crois qu’il est possible de réfléchir à la façon dont elle pourrait aider quelqu’un d’une manière différente de celle qu’on avait imaginée. »
Certains jours, Mme Deeb s’intéresse à des innovations telles que les revêtements extérieurs utilisés pour réduire la traînée et augmenter la vitesse des navires, et cherche à savoir si elles peuvent être utilisées pour réduire la pollution sonore. D’autres jours, elle étudie comment les systèmes autonomes prennent des décisions et fournissent des informations aux opérateurs sans les submerger de données inutiles. Chaque fois qu’elle se rend au travail, elle réfléchit à la manière de rendre la communication plus efficace à l’intérieur des systèmes autonomes et entre les personnes qui conçoivent ces systèmes et celles qui les utilisent.
Selon ses propres termes, « le génie peut être impossible à décrire, tant les domaines et les emplois potentiels sont nombreux. La meilleure façon de vraiment comprendre ce que l’ingénierie représente pour vous est de vous l’approprier ».
Les ingénieurs ne font pas que construire des ponts. Construire l’avenir est une série d’articles qui met en lumière les contributions importantes des ingénieurs et les nombreuses façons dont ils contribuent à la création d’un monde meilleur.


